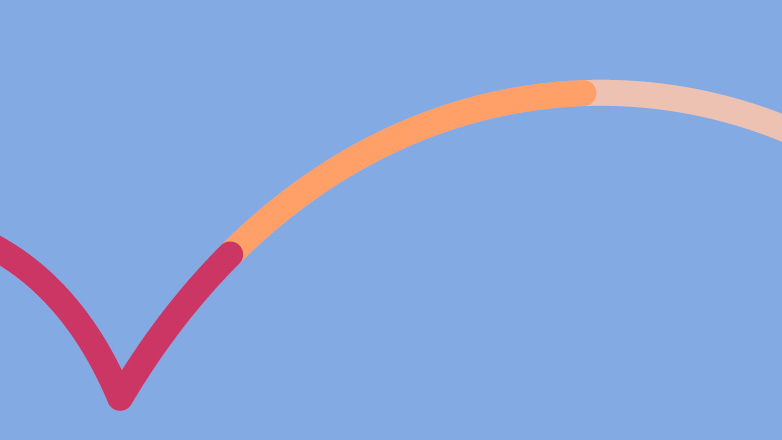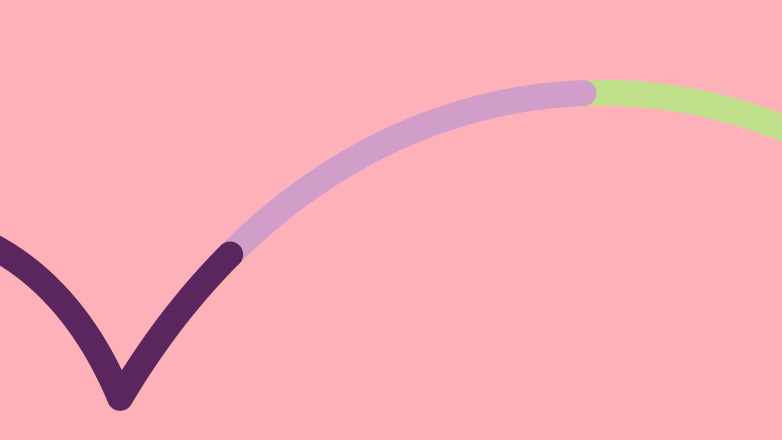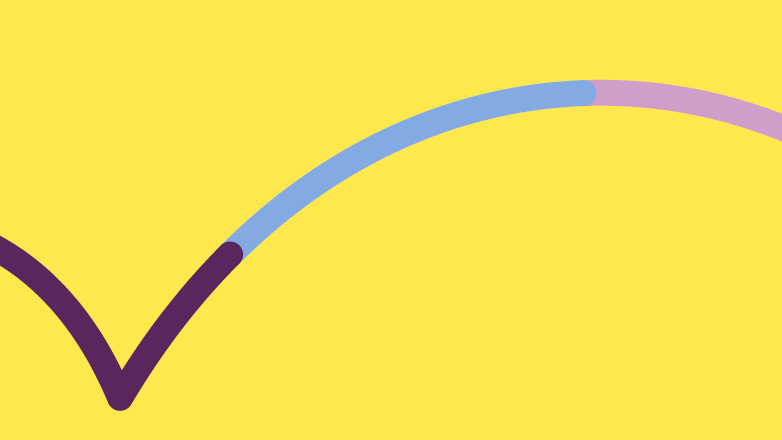La Newsletter Restructuring - Septembre 2017 - Responsabilité du banquier dispensateur de crédit: nouvelles précisions apportées par la Cour de cassation
Observations sur Cass. Com., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-132901
Encourt la censure l’arrêt qui retient la responsabilité d’un établissement de crédit pour soutien abusif au motif que la banque, qui ne dément pas les allégations des cautions tendant à lui imputer l'initiative de l'octroi d’un prêt et qui ne conteste pas les chiffres se rapportant aux résultats d'exploitation de l'entreprise cautionnée justifiés par les bilans produits aux débats, apparaît avoir nécessairement commis une faute d'immixtion répréhensible puisqu'elle s'est abstenue de tenir compte, par une analyse approfondie des résultats d'exploitation de la société bénéficiaire d'un plan de continuation, de la fragilité de la performance industrielle et commerciale de celle-ci avant de lui consentir deux crédits substantiels.
De tels motifs sont en effet impropres à caractériser une immixtion de la banque dans la gestion de la société, au regard de l’article L. 650-1 du Code de commerce. Ils sont, de même, impropre à établir le caractère fautif des crédits accordés, tenant à la pratique d'une politique de crédit ruineux pour l'entreprise financée de nature à provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement, ou tenant à l'apport d'un soutien artificiel à une entreprise dont la banque connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise.
1. On avait naïvement pu croire que l’introduction de l’article L. 650-1 du Code de commerce énonçant le principe d’irresponsabilité du prêteur de deniers à raison du crédit qu’il a consenti, aurait pu mettre un terme à cette exception française que sont les actions en responsabilité contre les banquiers initiées à la suite de l’ouverture d’une procédure collective de leur débiteur. Il est vrai que pendant quelques années, ces actions se sont taries. C’était toutefois sans compter sur cette propension du naturel à revenir à la surface. Et c’est donc sans surprise, qu’avec une intensité renouvelée, on a vu réapparaître ces demandes, parfois de liquidateurs, parfois encore d’actionnaires ou de dirigeants cautions malheureux.
Face à ces assauts répétés à l’encontre du principe posé à l’article L. 650-1 précité, la Cour de cassation n’a pas entendu fléchir, comme en témoigne un récent arrêt de censure du 22 mars 20171, qui mérite d’autant plus d’être relevé que les faits à l’origine du litige et les griefs formulés contre la banque sont aujourd’hui fréquents.
2. De cette affaire, on retiendra qu’une société avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Un plan de continuation avait été arrêté. En cours d’exécution du plan, la société débitrice a pu obtenir de la banque deux nouveaux crédits, garantis par deux cautionnements donnés par les associés de la société, l’un d’eux étant également gérant.
Faisant cependant face à de nouvelles difficultés, la société n’est pas en mesure d’exécuter les échéances du plan. Celui-ci sera finalement résolu et la société placée en liquidation judiciaire, tant et si bien que la banque se voit contrainte d’actionner les cautionnements qui lui ont été consentis. C’est dans ce contexte que les cautions tentent de mettre en œuvre la responsabilité de la banque à titre reconventionnel en arguant d’un soutien prétendument abusif.
3. Arrêtons-nous un instant sur la demande : l’on sait que l’article L. 650-1 du Code de commerce prévoit un principe de non responsabilité du prêteur de deniers pour les préjudices subis du fait des concours consentis à un débiteur faisant ultérieurement l’objet d’une procédure collective sauf les cas (i) de fraude, (ii) d’immixtion caractérisée dans la gestion ou (iii) de disproportion des garanties prises.
Comme c’est souvent le cas en pratique, c’est sous l’angle de « l’immixtion dans la gestion », que les demandeurs à l’action ont axé leur grief. Selon les cautions, l’attitude de la banque devait effectivement recevoir cette qualification dès lors qu’elle avait accordé un crédit à la société débitrice en négligeant ses mauvais résultats financiers.
Si l’argument est habituel, il est singulier de relever qu’il sera accueilli par la Cour d’appel de Nancy, aux termes d’une décision cédant visiblement à la tentation d’un allègement considérable des conditions de la responsabilité du prêteur de deniers à deux égards : (i) d’une part, en retenant une perception extensive de la notion d’ « immixtion caractérisée dans la gestion », (ii) d’autre part, en soustrayant le succès de l’action en responsabilité à l’exigence de la preuve complémentaire d’un crédit fautif en lui-même. C’est sur chacun de ces deux points que la censure de l’arrêt sera opérée.
I. L’ « immixtion dans la gestion » au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce
4. L’arrêt commenté trouve un premier point d’intérêt en ce qu’il constitue la première occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur la notion d’ « immixtion caractérisée dans la gestion » au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce.
Certes, le concept n’est pas inconnu. L’immixtion se définit génériquement comme « toute intervention sans titre dans les affaires d’autrui, se traduisant par l’accomplissement d’un acte »2. Inéluctablement, la notion d’ « immixtion caractérisée dans la gestion » renvoie donc à celle de « direction de fait », employée en particulier en matière d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (C. com., article L. 651-2).
D’ailleurs, le rapport du Sénateur Hyest rédigé en perspective de la loi du 26 juillet 2005, relevait précisément que la notion d’« immixtion caractérisée » recouvre « l’hypothèse, particulièrement rare, dans laquelle le créancier acquiert la qualité de dirigeant de fait en participant activement à la gestion du débiteur et en prenant seul des décisions importantes en ses lieu et place »3.
C’est donc une vision restrictive de l’immixtion qui était souhaitée par le législateur, « l’immixtion caractérisée dans la gestion » étant conçue comme équipollente à la « direction de fait ».
5. Cette conception a pour elle d’assurer une interprétation cohérente de l’article L. 650-1 du Code de commerce, l’« immixtion caractérisée dans la gestion » devant être appréciée avec la même rigueur que la notion de « fraude », seconde exception au principe de non responsabilité posée par la loi.
Elle offre également l’avantage de s’inscrire dans la continuité de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui, en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, a très souvent envisagé les notions d’ « immixtion dans la gestion » et celle de « direction de fait » comme étant interchangeables.
Les exemples jurisprudentiels où les deux notions sont employées indifféremment sont nombreux : ne caractérise par une situation de « direction de fait », le fait pour un banquier de conditionner ses concours à la communication d’un « état prévisionnel des dépenses » afin que la banque « donne ou refuse l'accord de règlement », « alors que l'accomplissement de tels actes est impropre à caractériser une immixtion fautive de la banque dans la gestion de la société emprunteuse (…) la [Banque] s'étant contentée d'exercer un contrôle de l'emploi des fonds prêtés dans l'attente des documents comptables réclamés »4.
De même, encourt le rejet, le pourvoi faisant grief à un arrêt d’appel d’avoir rejeté la demande tendant à voir reconnaître la responsabilité d’une banque « pour soutien abusif et pour immixtion dans la gestion », dès lors que la banque s’est bornée à s’assurer contractuellement le « contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière », ce qui « n'était pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client »5.
On pourrait multiplier ces exemples à l’envie6. Ils démontrent le caractère visiblement équivalent des notions d’ « immixtion dans la gestion » et de « direction de fait », autant d’ailleurs que la très grande vigilance de la Chambre commerciale à ne pas voir trop aisément retenir une situation de « direction de fait ».
C’est donc logiquement, et dans le prolongement de cette jurisprudence déjà acquise, que la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy dans la présente affaire.
6. Pour faire droit au moyen des cautions, l’arrêt d’appel s’était effectivement limité à relever que la banque n’avait pas « [démenti] les allégations des cautions tendant à lui imputer l’initiative de l’octroi du second prêt » et que « ne [contestant] pas les chiffres se rapportant aux résultats d’exploitation de l’entreprise cautionnée justifiés par des bilans produits aux débats, [elle] apparaît avoir nécessairement commis une faute d’immixtion répréhensible puisqu’elle s’est abstenue de tenir compte, par une analyse approfondie des résultats d'exploitation de la société bénéficiaire d'un plan de continuation, de la fragilité de la performance industrielle et commerciale de celle-ci avant de lui consentir deux crédits substantiels ».
C’est dire autrement que la Cour d’appel avait opté pour une conception extrêmement souple, sinon lâche, de l’immixtion, celle-ci étant – d’après l’arrêt – établie par cela seul que la banque aurait accordé deux crédits sans procéder à une analyse suffisamment approfondie des résultats de l’entreprise.
Or, c’est cette conception, portée par l’arrêt d’appel et soutenue par un nombre croissant de plaideurs, qui est désapprouvée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une immixtion de la [Banque] dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision », au regard du texte précité dont la Cour de cassation prend le soin de relever qu’il est « applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 même si les faits concernés sont antérieurs à cette date ».
Bien sûr, on pourra relever que la cassation est fondée sur un « simple » manque de base légale (donc une insuffisance de motivation en fait, en contemplation de la qualification juridique retenue), et non une violation de la loi. De même, faut-il souligner que l’arrêt n’a pas vocation à être publié. Ce sont là d’autant d’éléments qui témoignent de ce que la Cour de cassation n’entend pas s’enferrer dans une définition trop rigide, à l’instar de sa position qu’elle adopte en matière de contrôle de la qualification juridique de la « direction de fait ».
Une chose est néanmoins certaine : en statuant de la sorte, la Cour régulatrice tourne le dos aux tenants d’une conception élargie de la notion d’ « immixtion caractérisée dans la gestion » et adresse un message sans équivoque aux juridictions du fond. Tel n’est, au demeurant, pas le seul apport de l’arrêt.
II. Le caractère fautif du concours au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce
7. On se souvient que par deux arrêts, le premier du 27 mars 20127 et le second du 16 décembre 20148, la Cour de cassation avait eu l’occasion d’expliciter le mécanisme de conditions à deux niveaux qui devait encadrer la responsabilité du banquier en application de l’article L. 650-1 précité : « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ».
La Cour de cassation n’avait cependant pas eu l’occasion d’expliciter les conditions dans lesquelles le concours pouvait être qualifié de fautif. L’arrêt commenté du 22 mars 2017 est l’occasion de combler cette lacune. La cassation est ici remarquable.
8. Alors que la censure de l’arrêt d’appel sur la première branche du moyen était suffisante, la Cour de cassation, sacrifiant à sa tradition de concision9, s’est effectivement fendue d’une cassation additionnelle, parfaitement surabondante et sans autre finalité que celle de poursuivre son travail de construction du régime de responsabilité institué par l’article L. 650-1 du Code de commerce.
Revenons à l’arrêt : en statuant comme elle l’avait fait, la Cour d’appel avait effectivement retenu la responsabilité du prêteur du seul fait d’une prétendue immixtion du banquier – par ailleurs, appréciée de façon erronée – dans la gestion de la société débitrice. En statuant de la sorte, la Cour d’appel s’affranchissait par conséquent de l’analyse à double détente de la responsabilité du prêteur instituée par la Cour régulatrice.
Un nouveau cas d’ouverture à cassation était donc disponible, et la Cour de cassation s’en est saisi pour compléter sa doctrine : « en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir le caractère fautif des crédits accordés, tenant à la pratique d'une politique de crédit ruineux pour l'entreprise financée de nature à provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement, ou tenant à l'apport d'un soutien artificiel à une entreprise dont la [Banque] connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Par ce biais, la Chambre commerciale confirme qu’il n’est pas de raison de se départir de sa jurisprudence antérieure à la loi de sauvegarde pour apprécier le caractère fautif du crédit. C’est ainsi que le critère énoncé dans l’arrêt commenté est identique à celui qu’elle avait posé dans son arrêt du 22 mars 200510 et rappelé dans des décisions plus récentes rendues sous l’empire de la loi ancienne11
Cette position est parfaitement logique. Elle est conforme à l’objectif de la loi de sauvegarde qui, rappelons-le, était également de rompre avec une tradition de contentieux opportunistes, dont le principal effet est de décourager le crédit12 et, accessoirement, les investissements étrangers.
1. Cass. Com., 22 mars 2017, pourvoi n°15-13290, RJDA 6/2017 n° 389, p.484-485.
2. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF coll. Quadrige, publié sous la direction de Gérard Cornu, V° Immixtion.
3. Rapport J.-J. Hyest n°335, p.442.
4. Cass. Com., 7 janvier 2004, pourvoi n° 01-02896.
5. Cass. Com., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-12677
6. V. encore, Cass. Com., 18 janvier 2000, pourvoi n° 97-19010 ; Cass. Crim., 12 décembre 1988, pourvoi n° 88-81353 : Bull. Joly 1989, p. 252 note Streiff, Cass. Com., 3 juillet 2007, pourvoi n° 06-10803. La doctrine va également dans ce sens : P-M. Le Corre, Droit et Pratique des Procédures Collectives, Dalloz Action ; D. Legeais, « Les concours consentis à une entreprise en difficulté », JCP E, 2005, 1510, n°14 ; P. Hoang, « Risque d’entreprise et risque indemnitaire des partenaires externes de l’entreprise en difficulté », Les Petites Affiches, 10/07/2013, n°137 ; V. néanmoins, pour une position plus nuancée : F. Macorig-Venier, « Le soutien abusif », Rev. Lamy Aff. 2008, p.119.
7. Cass. Com., 27 mars 2012, pourvoi n° 10-20077, Bull. IV n° 68.
8. Cass. Com., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-23748.
9. C. Witz, « Libres propos d’un universitaire français à l’étranger », RTD civ. 1992, p. 737 ; A. Breton, « L’arrêt de la Cour de cassation », Ann. Université sciences sociales de Toulouse, 1975, p. 7, p. 28 et s.
10. Cass. Com. 22 mars 2005, 22 mars 2005, Bull. IV n° 67, pourvoi n° 03-12922.
11. Cass. Com., 8 janvier 2013, pourvoi n° 11-27120, Adde Cass. Com., 13 septembre 2011 10-20.760.
12. Cons. const., 22 juillet 2005, n° 2005-522 DC.