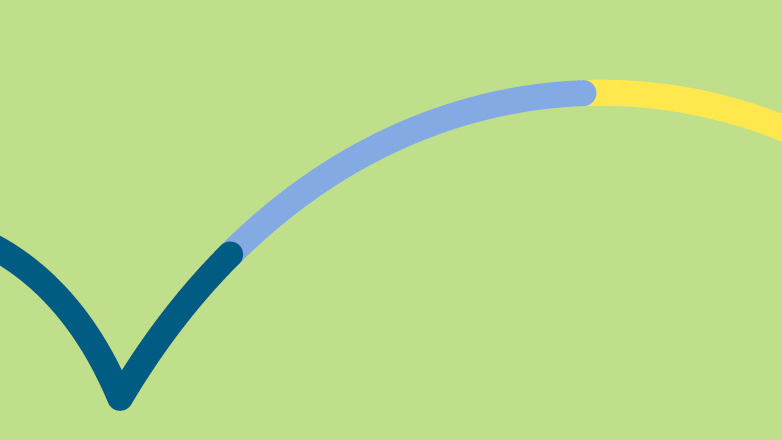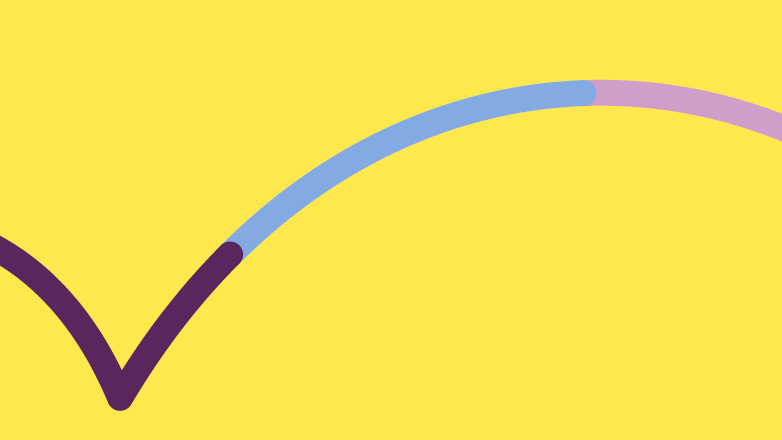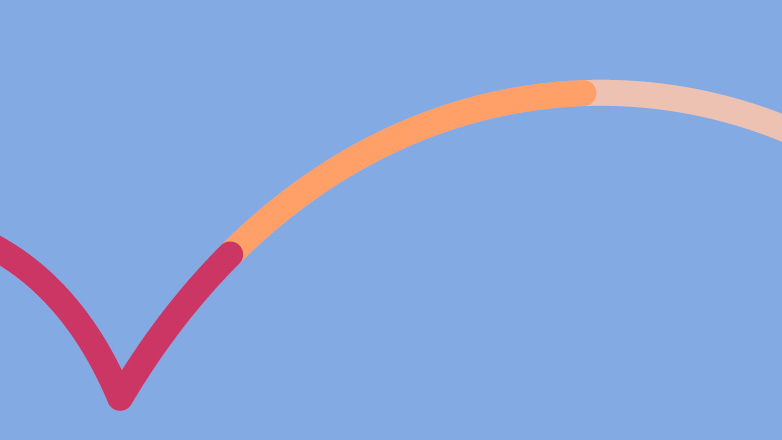Actualité sociale - Mars / avril 2021
Dans cette édition nous aborderons les thèmes et jurisprudences suivants :
• Convention individuelle de forfait jours : l'importance de l'entretien annuel d'évaluation
• Un élu peut prétendre au paiement de ses heures de délégation pendant sa dispense d'activité rémunérée
• Harcèlement sexuel et résiliation judiciaire
• La contractualisation d'un bonus versé annuellement
• Les titres-restaurant ne sont pas dus aux salariés placés en télétravail à domicile
• Santé du salarié : l'importance des préconisations du médecin du travail
• Sur l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié inapte des motifs s'opposant à son reclassement
• Licenciement nul : le salarié ayant retrouvé un autre emploi peut exercer son droit à réintégration
• Le licenciement prononcé à la suite d'une absence prolongée ayant pour origine une faute de l'employeur est nul
• Licenciement collectif pour motif économique et unité économique et sociale
• Discrimination : le droit à la preuve et la communication de données non anonymisées
Jurisprudence - Exécution du contrat de travail
Convention individuelle de forfait jours : l'importance de l'entretien annuel d'évaluation
En omettant d'organiser l'entretien annuel d'évaluation pendant 5 années consécutives, l'employeur commet un manquement à ses obligations légales et conventionnelles pour s'assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié. La convention individuelle de forfait annuel en jours est donc privée d'effet.
Cass. soc., 17 février 2021, 19-15.215
Cet arrêt reprend les différents principes établis par la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
Le non-respect des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait-jours annuel prive d'effet la convention individuelle de forfait (Cass. soc., 2 juillet 2014, n°13-11.940).
En cas de litige, la charge de la preuve repose sur l'employeur : ce dernier doit donc prouver qu'il a bien respecté les stipulations de cet accord collectif (Cass. soc., 19 décembre 2018, n°17-18.725).
S'il ne parvient à démontrer qu'il a bien respecté les obligations de suivi de la charge de travail auprès du salarié, ceci aura notamment pour conséquences (Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-23.314) :
• La privation d'effet de la convention individuelle de forfait-jours ;
• Le versement d'un rappel d'heures supplémentaires accomplies durant cette période d'inexécution de l'accord.
En l'espèce, l'employeur n'étant pas parvenu à prouver la réalisation de cet entretien, pour les années 2005 à 2009 :
• D'une part, la convention de forfaits-jours a ainsi été jugée privée d'effet,
• D'autre part, l'employeur a été condamné à verser au salarié la somme de 350.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour avoir négligé ces entretiens durant plusieurs années.
Un élu peut prétendre au paiement de ses heures de délégation pendant sa dispense d'activité rémunérée
En application de l'ancien article L.4614-6 du Code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel.
Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.
Cass. soc., 3 mars 2021 n°19-18.150
Par principe, le crédit d'heures accordé aux représentants du personnel pour exercer leur mandat est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif et payé comme tel à l'échéance normale de paye (C. trav. art. L.2315-10).
A ce titre, lorsque pour les nécessités du mandat, les heures de délégation sont prises en dehors des horaires de travail, elles sont rémunérées comme des heures supplémentaires (Cass. soc., 14 octobre 2020, n°18-24.049).
En l'espèce, un salarié protégé adhère à un dispositif de congé de maintien dans l'emploi des salariés seniors, et bénéficie d'une dispense totale d'activité rémunérée jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein.
Il soutient que les heures de délégation prises durant cette période, pendant laquelle son mandat n'est pas suspendu, doivent être réglées en sus de la rémunération qui lui est versée.
La Cour de cassation lui donne raison : l'employeur, auquel il appartient de fixer l'horaire de travail, n'avait pas défini les horaires de travail théoriques durant sa période de dispense d'activité.
Celui-ci était donc bien fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation durant ladite période.
En conséquence, durant une période de dispense d'activité rémunérée, il est nécessaire pour l'employeur d'établir un planning théorique des heures de travail que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé.
L'employeur ne prenant aucune mesure pour éloigner le supérieur hiérarchique, auteur des faits de harcèlement sexuel dont a été victime la salariée, ayant développé un syndrome dépressif réactionnel, commet un manquement à son obligation de sécurité suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs.
Le simple avertissement adressé à l'auteur des faits de harcèlement sexuel est insuffisant.
Cass. soc., 17 février 2021, n°19-18.149
A l'inverse, lorsque l'employeur, informé des faits de harcèlement sexuel dont a été victime la salariée, met fin à cette situation en licenciant son supérieur hiérarchique, auteur des faits fautifs, alors celui-ci ne commet pas de manquement à son obligation de sécurité.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée est alors rejetée.
Néanmoins, les faits de harcèlement sexuel étant établis, cette dernière est en droit de percevoir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Cass. soc., 3 mars 2021, n°19-18.110
Ces deux arrêts de la Cour de cassation soulignent l'importance de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur envers ses salariés (C. trav. art. L.4121-1), ainsi que le rôle des juges du fond dans l'appréciation du manquement de l'employeur à son obligation.
Dès lors que l'employeur a connaissance des faits de harcèlement sexuel et moral, et qu'il prend les mesures nécessaires à la protection du salarié, alors celui-ci ne manque pas à son obligation de sécurité (Cass. soc., 11 mars 2015, n°13-18.603).
Ainsi, le salarié doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, si au jour du jugement, l'employeur a fait cesser la situation dont se plaint l'intéressé (Cass. soc., 28 novembre 2018, n°17-22.724), notamment si l'employeur licencie l'auteur des faits avant même le saisine du conseil de prud'hommes. Le simple avertissement est donc insuffisant.
Pour autant, si les faits de harcèlement sexuel et/ou moral sont établis, le salarié peut percevoir une indemnisation pour le préjudice subi qui, selon une étude des décisions récentes de la Cour d'appel de Paris, s'élève entre 1 et 4 mois de salaire environ.
La contractualisation d'un bonus versé annuellement
En relevant que le salarié avait perçu de l'année 2000 à 2011 une rémunération variable, en sus de son salaire fixe, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le montant de cette rémunération était fixée discrétionnairement par l'employeur, mais a retenu qu'elle l'était selon des critères définis par lui, a souverainement retenu que le paiement chaque année pendant 12 années consécutives, d'une rémunération variable, établissait que les parties avaient entendu contractualiser le versement en sus du salaire fixe, d'une rémunération variable, peu importe la dénomination qui lui était donnée.
Cass. soc., 10 mars 2021, n°19-18.078
En l'espèce, un salarié adhère un plan de départ volontaire. En décembre 2013, il quitte effectivement l'entreprise.
Par la suite, il saisit la juridiction prud'homale et demande notamment un rappel de bonus au titre des années 2012 et 2013.
L'employeur soutient que le bonus est issu d'un engagement unilatéral de la société, qui a décidé de faire bénéficier à ses salariés relevant de la catégorie "cadres", exclus du plan de commissionnement, d'un programme de bonus annuel discrétionnaire, sans que cela ne résulte d'une obligation contractuelle ou conventionnelle.
Or, ni la Cour d'appel de Versailles, ni la Cour de cassation n'adhère à cet argumentaire et juge au contraire que le bonus est entré dans le champ contractuel obligeant l'employeur à en poursuivre l'application.
A ce titre, il convient de préciser la Cour d'appel de Versailles a récemment conclu à la contractualisation d'un bonus, versé durant plusieurs années, dans deux autres affaires distinctes (CA Versailles, 31 janvier 2019, n°16/04981 ; CA Versailles, 31 janvier 2019, n°16/04985).
Les titres-restaurant ne sont pas dus aux salariés placés en télétravail à domicile
N'étant pas dans une situation comparable à celle des salariés travaillant sur site, et n'ayant pas accès au restaurant d'entreprise, les salariés en télétravail ne peuvent pas prétendre à l'attribution de titres-restaurant.
Tribunal Judiciaire de Nanterre, 10 mars 2021, n°20/09616
A compter du 17 mars 2020, les entités composant l'UES Malakoff Humanis placent la plupart de leurs salariés en télétravail en raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, et n'attribuent plus des titres-restaurant aux salariés de l'entreprise placés en télétravail.
Estimant que ces derniers doivent également bénéficier de titres-restaurant, une fédération syndicale saisit le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la régularisation de leurs droits depuis le 17 mars 2020. Ledit tribunal déboute la fédération de sa demande :
• En premier lieu, le juge rappelle, comme le ministère du travail (QR min. trav. mis à jour le 25 mars 2021), que :
o Le titre-restaurant est un avantage consenti par l'employeur qui ne résulte d'aucune obligation légale ;
o Son attribution est possible, si et seulement si, en application de l'article R. 3262-7 du Code du travail, le repas du salarié est compris dans son horaire de travail journalier ;
• En second lieu, le juge précise, que contrairement aux salariés présents sur site sans restaurant d'entreprise, les salariés en télétravail ne subissent aucun surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile. Dès lors, ces derniers ne peuvent prétendre à l'attribution de titres-restaurant.
La jurisprudence constante considère que l'attribution d'un avantage peut être subordonnée à certains critères objectifs. Il a notamment été jugé que l'employeur peut différencier l'attribution de titres-restaurant en fonction de l'éloignement du travail par rapport au domicile, car cette différenciation est fondée sur un critère objectif (Cass. soc., 21 janvier 1992, n°88-40.938).
Dans une autre affaire, le Tribunal Judiciaire de Paris a récemment rendu un jugement contredisant la position retenue par les juges de Nanterre (Tribunal Judiciaire de Paris, 30 mars 2021, n°20/09805).
Santé du salarié : l'importance des préconisations du médecin du travail
Cass. soc. 24 mars 2021, n°19-16.558
L'employeur interprète cet avis comme un avis d'inaptitude. Selon lui, les restrictions constatées par le médecin du travail, lorsqu'elles impliquent l'affectation du salarié sur un autre poste ou la modification de son contrat de travail, ne peuvent conduire qu'à la formulation d'un avis d'inaptitude.
• D'une part, "que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur ";
• D'autre part, "que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail".
L'employeur est donc tenu d'aménager le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail. S'il ne parvient pas à démontrer qu'il était dans l'impossibilité de le faire, le licenciement prononcé suite au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail est alors jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6 février 2013, n°11-28.038).
Sur l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié inapte des motifs s'opposant à son reclassement
Dans un contexte d'inaptitude pour origine professionnelle, l'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent à son reclassement lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi.
Il n'est pas tenu de cette obligation, lorsqu'un salarié refuse un emploi qui lui a été proposé et conforme aux prescriptions légales.
Cass. soc. 24 mars 2021, n°19-21.263
Par principe, lorsqu'il est impossible pour l'employer de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, il doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, aussi bien en cas d'inaptitude non professionnelle (C. trav. art. L.1226-2-1) que d'inaptitude professionnelle (C. trav. art. L.1226-12 ; Cass. soc., 20 décembre 2017, n°16-16.378)
En l'espèce, un salarié victime d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail. Malgré deux propositions de postes de reclassement par l'employeur, celui-ci les refuse. Il alors licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement, et demande des dommages et intérêts pour non information des motifs de l'impossibilité de reclassement. La Cour de cassation, tout comme la Cour d'appel, rejette sa demande.
En effet, lorsque le salarié refuse deux propositions de poste de reclassement, conforme aux dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail, l'employeur se retrouve alors délié de cette obligation.
Par cette décision, la Cour de cassation précise l'absence d'obligation de double information : le salarié sait déjà, par le contexte, pourquoi l'employeur n'a pas été mesure de le reclasser. Une répétition de cette information est alors inutile.
Jurisprudence - Rupture du contrat de travail
Licenciement nul : le salarié ayant retrouvé un autre emploi peut exercer son droit à réintégration
L'employeur n'apportant pas la preuve que la réintégration du salarié est matériellement impossible, le fait pour ce dernier, dont le licenciement est jugé nul, d'être entré au service d'un nouvel employeur n'est pas de nature à la priver de son droit à réintégration.
Cass. soc., 10 février 2021, n°19-20.397
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du Code du travail, lorsque le licenciement est atteint de nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est matériellement impossible, le juge lui octroie une indemnité.
En l'espèce, en 2012, un salarié a été licencié pour motif personnel. En 2019, sur renvoi après cassation, la Cour d'appel prononce la nullité du licenciement au motif des agissements de harcèlement moral dont a été victime le salarié, et ordonne la réintégration de ce dernier après avoir constaté que celle-ci n'était pas matériellement impossible.
Au jour où la Cour d'appel statue, le salarié licencié est titulaire d'un nouveau contrat de travail le liant à un autre employeur. L'ancien employeur estime alors que la réintégration est matériellement impossible, puisqu'en tout état de cause, le salarié devait "préalablement démissionner de son emploi en respectant un préavis de deux mois".
Néanmoins, la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement : elle reste fidèle à sa ligne jurisprudentielle (Cass soc., 21 octobre 1992, n°90-42.477 ; Cass. soc., 2 février 2005, n°02-45.085).
La notion d'impossibilité matérielle à réintégration est appréciée de manière restrictive. La réintégration a été jugée matériellement impossible dans des cas très limités, notamment :
• Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et a disparu (Cass. soc., 20 juin 2006, n°05-44.256) ;
• Lorsque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite (Cass. soc., 13 février 2019, n°16-25.764).
Le licenciement prononcé à la suite d'une absence prolongée ayant pour origine une faute de l'employeur est nul
Lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à ses obligations, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.
Cass. soc., 10 mars 2021, n°19-11.305
La Cour de cassation avait déjà adopté une position similaire, notamment lorsque :
• Lorsque l'arrêt maladie du salarié est la conséquence d'une exposition à un stress permanent et prolongé en raison d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel (Cass. soc., 13 mars 2013, n°11-22.082).
Licenciement collectif pour motif économique et unité économique et sociale
Lorsque les licenciements pour motif économique envisagés résultent d'un seul et même projet décidé au niveau de l'unité économique et sociale (UES), l'appréciation des conditions déclenchant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de celle-ci.
Cass. soc., 17 mars 2021, n°18-16.947
L'employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque sont envisagés au moins 10 licenciements sur une même période de 30 jours (C. trav.art.L.1233-61). Plus précisément, c'est au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée que s'apprécient les conditions les conditions d'établissement d'un PSE (Cass. soc., 16 janvier 2008, n°06-46.313).
Les conditions d'effectif et le nombre de licenciements envisagés s'apprécient, par principe, au niveau de l'entreprise (Cass. Soc., 28 janvier 2009, n°07-45.481).
Par exception, si la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES, c'est dans le cadre de cette entité que ces conditions s'apprécient (Cass. soc., 16 novembre 2010, n°09-69.485 ; Cass. soc., 8 janvier 2020, n°18-16.945). Dans l'arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation fait un rappel de sa jurisprudence constante.
En l'espèce, 15 salariés d'une société holding, dont un salarié protégé, sont licenciés pour motif économique. Au regard de l'effectif de l'entreprise et du nombre de licenciements envisagés, l'employeur n'établit pas de PSE.
En parallèle, les salariés saisissent ultérieurement le tribunal d'instance aux fins de reconnaître l'existence d'une UES. Les juges de première instance font droit à leur demande. De son côté, le salarié protégé saisit également la juridiction prud'homale et demande notamment la nullité de son licenciement, au motif que l'employeur aurait dû établir un PSE.
Il soutient que les licenciements envisagés participaient d'un seul et même projet décidé au niveau de l'UES. Les conditions d'effectif et le nombre de licenciements envisagés auraient dû donner lieu à la mise en œuvre d'un PSE. Ce raisonnement est suivi par la Cour de cassation.
Jurisprudence - Contentieux
Discrimination : le droit à la preuve et la communication de données non anonymisées
Dans le cadre d'une demande de mesures d'instructions d'un salarié, la communication de données personnelles d'autres salariés, sans leur accord, peut être rendue nécessaire par l'exercice du droit à la preuve aux fins d'établir la discrimination fondée sur le sexe.
Cass. soc., 16 mars 2021, n°19-21.063
En l'espèce, afin de prouver la discrimination fondée sur le sexe dont s'estime être victime la salariée, elle demande que lui soient transmis des données personnelles non anonymisées (date d'embauche, coefficient et salaire) concernant dix hommes actuellement salariés au sein de la société et occupant le même poste.
Pour rejeter la demande de la salariée, la Cour d'appel s'appuie sur le refus de cinq d'entre eux à voir communiquer leurs données, et notamment leurs bulletins de paie qui comprend des informations personnelles (âge, salaire, adresse etc.), et le droit au respect de leur vie privée.
Au visa de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d'appel.
Si la production des éléments demandés sans l'accord des salariés porte atteinte à leur vie privée, les juges auraient dû "rechercher au moyen d'un contrôle de proportionnalité, si la communication des informations non anonymisées n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi". Dans cette hypothèse, l'accord des salariés n'était donc pas requis.
Cette décision s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle de la Haute Cour qui avait déjà admis que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes une obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, sous réserve que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées (Cass. soc. 19 décembre 2012, n°10-20.526).